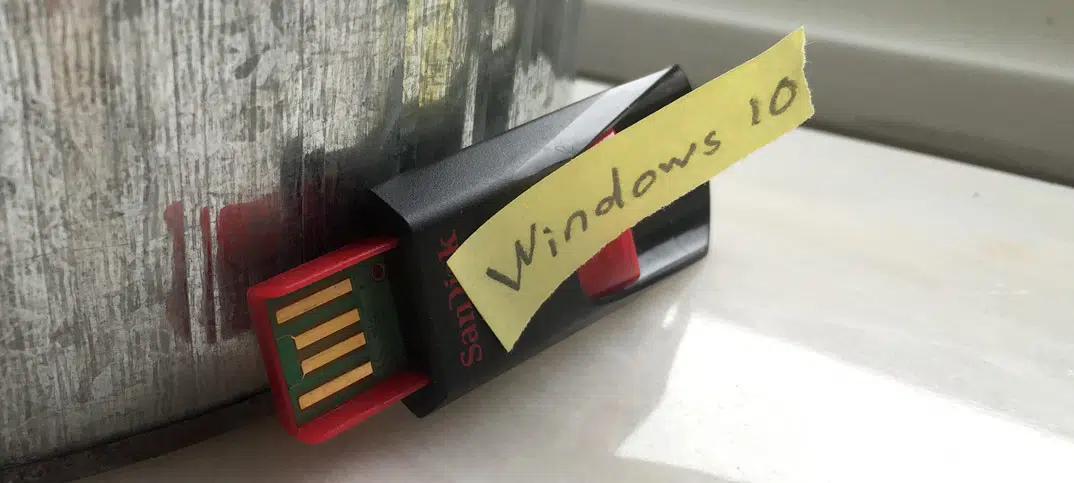À une époque de concurrence toujours plus forte pour les emplois, un diplôme universitaire n’est plus la garantie d’un avenir sûr. Vous allez maintenant obtenir 300 crédits universitaires, mais n’hésitez pas à un emploi supplémentaire et à un mérite unique.
Nous sommes en avril, période où le soleil se fait plus généreux. Les étudiants de l’École d’économie filent dehors dès la fin des cours pour profiter des derniers rayons. Mais certains restent. Dans le hall E220, une vingtaine d’étudiants assistent au dernier séminaire du Career Center. Gustav Freedholm, du syndicat ST, s’apprête à ouvrir sa conférence : « Comment écrire le CV qui vous décroche un emploi ».
Les carnets s’ouvrent, les stylos grattent. Les conseils de Gustav sont pris très au sérieux : un CV solide ne suffit pas, il doit raconter un parcours. Les expériences en dehors des études, jobs d’été, engagements associatifs, pèsent lourd dans la balance. Gustav Freedholm le confirme : c’est ainsi qu’il a trouvé sa première place.
À cinq kilomètres de là, Fredrik Gertzell occupe un bureau dans la succursale régionale de l’entreprise de construction Peab. Deux ans plus tôt, il terminait sa maîtrise en économie à Lund. Aujourd’hui, il surveille les coûts d’un chantier à Simrishamn, bien loin de ce qu’il avait imaginé pour sa carrière. Son diplôme, l’a-t-il aidé à décrocher ce poste ? Il hésite. « Les connaissances acquises ne sont jamais superflues et le diplôme prouve qu’on sait se débrouiller de façon autonome. Mais je ne suis pas certain que ce soit décisif pour trouver un emploi », raconte-t-il.
Étudiant, il ne se préoccupait guère de ses perspectives après la remise des diplômes. Un master supplémentaire s’est imposé presque par défaut : un simple bachelor lui semblait léger. « J’ai grandi à la campagne, mon père est agriculteur, alors j’ai toujours travaillé à la ferme l’été. Après mon mémoire, je suis parti bosser, puis j’ai envisagé de postuler à l’automne. »
L’été passé, Fredrik démarre sa recherche d’emploi. « Dès l’automne, j’ai compris à quel point c’était difficile sans avoir bossé dans une banque ou occupé un job pertinent plus tôt. Rien qui fasse la différence, aucun stage, aucun engagement marquant sur mon CV », analyse-t-il aujourd’hui.
L’automne et l’hiver passent sans qu’il ne décroche une seule offre. Il multiplie les candidatures, sans succès. « C’était franchement frustrant, avec tous ces sites de recrutement, chacun avec ses propres règles. Un jour, il fallait un CV en PDF, le lendemain remplir un formulaire interminable… On finit par s’user. »
Fredrik Gertzell, passé par un master en économie, travaille aujourd’hui chez Peab. Photo : Annika Forêts
En mars, sa sœur croise une connaissance de la famille travaillant chez Peab à Malmö. Coup de fil : peut-être un poste à saisir pour Fredrik. « Un employé saisonnier venait de partir. Ce n’était pas le job de mes rêves, mais j’avais les bonnes compétences grâce à mon expérience à la ferme. Je savais manier une tronçonneuse, utiliser une tondeuse. »
En huit mois, Fredrik décroche son premier poste. Le projet d’un emploi dans une banque laisse place à la plantation de fleurs à Bunkeflostrand. Peu importe : il voulait simplement travailler.
La satisfaction ne dure pourtant qu’un temps. En juillet, lors d’un enterrement de vie de garçon, il se fracture le pied. « Un sale coup. Je venais à peine de sortir la tête de l’eau et me voilà en arrêt jusqu’en octobre. »
Rester à ne rien faire lui est insupportable. Il convainc l’entreprise de lui confier des tâches administratives. Fin octobre, lorsqu’il se débarrasse de son plâtre, un poste s’ouvre au bureau. Fredrik le décroche. « J’étais en période d’essai, mais dès que j’ai pu retravailler, je n’ai jamais remis les pieds sur le chantier. »
En mars, il obtient un CDI. Son bureau, désormais, il peut le considérer comme le sien. « C’est assez incroyable qu’ils soient si contents de moi. Je n’avais jamais eu de poste permanent avant. Je découvre chaque jour des choses nouvelles, les réseaux d’eaux pluviales, le coût d’un lampadaire… »
Un contact, un pied dans une entreprise : parfois, il ne faut pas plus pour passer la porte. Pour ceux qui ne visent pas un métier à accréditation, c’est souvent la clé d’accès au marché du travail. Caroline Tovatt, docteure en ethnicité et migration, a consacré sa thèse à l’importance des réseaux dans la recherche d’emploi. « Un poste, c’est parfois des centaines de candidatures. Il faut quelqu’un pour vous recommander », explique-t-elle.
Les embauches via des contrats saisonniers ou des vacations, rarement annoncées officiellement, sont monnaie courante. Pour en avoir connaissance, un tuyau, un contact, c’est décisif. Les réseaux personnels facilitent l’accès à l’information et à l’emploi.
Les recherches de Caroline Tovatt montrent un changement profond dans les pratiques de recrutement. « Jusqu’au début du XXe siècle, les postes se transmettaient surtout par le biais familial et la réputation. Puis, on a voulu démocratiser l’accès au travail, d’où l’idée que la formation et les compétences devaient primer sur le nom ou l’origine. »
Ce mouvement a mené à la création du Service de l’emploi en 1902, puis à l’obligation en 1976 de déclarer tous les postes vacants. « À cette époque, le marché de l’emploi était dynamique. Dans les années 70 et 80, le chômage descend parfois à 1 %. »
Avec la crise de 1991, le chômage bondit à 10 %, et les relations personnelles retrouvent leur place. Aider les proches, cela n’a jamais disparu, mais jusque-là, on croyait que les annonces suffisaient à réguler le marché.
Selon Caroline Tovatt, la situation actuelle ressemble à celle du XIXe siècle : réseau familial et cercle d’amis pèsent davantage que les diplômes ou l’expérience. Les codes ont changé, mais le carnet d’adresses reste une arme redoutable.
La conséquence : un réseau solide devient un véritable accélérateur. Celui qui a des liens sociaux dès le départ part avec un avantage. « Être né à Stockholm, c’est être intégré dans un tissu de contacts que n’aura pas un étudiant arrivant du nord du pays. Bien sûr, le marché du travail n’est pas uniforme selon les secteurs. »
L’enquête menée par l’Université de Lund en 2014 révèle un écart flagrant : les anciens étudiants d’origine étrangère étaient quatre fois plus nombreux à chercher un emploi que les diplômés suédois. Même formation, même diplôme, mais tout ne se joue pas sur les bancs de l’université. Pour autant, Caroline Tovatt ne considère pas que le diplôme est devenu inutile. « Un cursus académique ne garantit pas un poste, mais sans cela, on n’accède même pas aux emplois qualifiés. »
Prendre un poste qui ne correspond pas à son niveau d’études est devenu courant. Selon le rapport « Matching on the Swedish labour market » (2012), un tiers des salariés suédois occupait un emploi pour lequel ils étaient surqualifiés.
À mesure que les générations peu diplômées partent à la retraite, la part de personnes très qualifiées grimpe dans la population active. Pourtant, le gouvernement considère que la demande de diplômés du supérieur n’a jamais été aussi forte. Les employeurs, eux, rehaussent leurs critères tous les dix ans depuis les années 1970.
Åsa Löfström, professeure d’économie à l’université d’Umeå et co-autrice de l’ouvrage « The Long Road to the Labour Market » (2014), tempère le discours sur la disparition des emplois accessibles. Ce ne sont pas les postes qui se font rares, mais le niveau d’études général qui s’élève. Mécaniquement, cela pousse les employeurs à privilégier les profils les plus diplômés, même pour des tâches de base. « Ce n’est pas que la caisse d’un supermarché exige un diplôme universitaire, c’est que les candidats diplômés sont plus nombreux. »
Åsa Löfström observe aussi que les femmes acceptent plus souvent que les hommes des emplois ne correspondant pas à leur qualification. « Les femmes sont souvent pressées de s’insérer rapidement sur le marché du travail, notamment avant d’envisager d’avoir des enfants. »
Le stress d’obtenir un pied dans le monde professionnel, Åsa Löfström le constate auprès de ses étudiants. « Aujourd’hui, tout le monde s’attend à ce qu’un étudiant ait, en plus de ses études, des expériences supplémentaires. On parle de la baisse du niveau en université, mais personne ne fait le lien avec la charge qui pèse sur les étudiants. »
Elle constate aussi qu’elle-même conseille désormais à ses élèves de penser à leur CV dès les travaux écrits. « On leur dit : faites en sorte que cet essai puisse figurer dans votre CV. Il y a vingt ans, on ne parlait même pas de CV. »
Philip Eriksson fait partie de ceux qui ont réfléchi à leur CV dès leurs études. Il vient de soutenir son mémoire de master en géographie communautaire.
Philip Eriksson, tout juste diplômé d’un master en géographie communautaire. Photo : Lukas J. Herbers
Installé au Café Athens, il savoure la satisfaction du travail accompli. Le puzzle de la vie étudiante se referme. « Je n’ai pas été obsédé par la rédaction de mon mémoire, mais il vaut mieux pouvoir annoncer dans les candidatures que les études sont terminées. »
Ces dernières années ont été traversées par l’incertitude chez ses camarades. « Beaucoup ont quitté Skåne, certains pour Stockholm, d’autres sont partis jusqu’au Norrland. »
Philip s’est installé à Lund en 2010 pour débuter un cursus en sciences politiques. Le choix de la ville s’est fait par envie d’éloignement de son Falun natal. Le métier visé restait flou. « J’avais vaguement envie de travailler dans le secteur public, mais c’est seulement lors de la dernière année de master que j’ai compris que l’aménagement du territoire me passionnait. » Même sans plan tracé, il multiplie les initiatives pour élargir ses perspectives : semestre de stage dans un bureau régional suédois à Bruxelles, échange en Australie, engagement dans un corps associatif. Autant d’expériences qu’il espère valoriser.
Philip a aussi multiplié les candidatures. Au printemps, il dépose une trentaine de dossiers, décroche trois entretiens, sans suite. Les postes reviennent souvent à des candidats plus expérimentés, parfois à des profils prédestinés. « Beaucoup d’annonces semblent écrites pour une personne précise. On lance une offre pour respecter la procédure, mais tout est déjà joué. »
À ce jour, Philip n’a pas de logement fixe. Il passe de canapé en canapé entre Stockholm, Lund et Falun, ce qui lui permet de limiter ses dépenses et de garder de la souplesse. « Je finirai bien par trouver un emploi. Ne pas avoir de charges fixes me permet d’attendre un peu. » Mais combien de temps pourra-t-il tenir ainsi ? Le doute s’installe vite. « Au pire, je referai un stage. Beaucoup de recruteurs exigent déjà une année d’expérience ; un stage supplémentaire, ce serait ça de pris. »
Malgré la pression sur l’expérience, les compétences et les CV bien garnis, le constat est là : les diplômés restent privilégiés. En Suède, le chômage chez les diplômés est deux fois plus faible que dans l’ensemble de la population active. Ce sont ceux restés à la porte de l’université qui se retrouvent les plus fragilisés, même si le métier visé n’a pas vu ses exigences augmenter.
Eva Oscarsson, enquêtrice à la centrale syndicale Saco, observe que les employeurs recrutent largement via le bouche-à-oreille. Elle souligne la nécessité de renforcer l’accompagnement des jeunes diplômés et des nouveaux arrivants, souvent dépourvus de réseau.
Selon elle, le Service de l’emploi devrait mieux soutenir la création de contacts, et les acteurs du secteur pourraient développer davantage de programmes de mentorat. « J’ai été mentor pour une femme de Bosnie dans le programme Jusek : pouvoir la mettre en relation avec mon réseau l’a réellement aidée dans sa recherche. »
Et la valeur du diplôme ? Faut-il envisager, dans dix ans, de brandir un doctorat pour décrocher un premier entretien ? Åsa Löfström, économiste, sourit à cette idée. « On vit une période d’inflation éducative. Je ne dis pas qu’il faut moins se former, mais il est urgent de repenser la façon dont le marché du travail intègre les différents niveaux de qualification. Aujourd’hui, la situation pousse certains jeunes à renoncer aux études longues. »
Peut-être est-il temps de considérer l’université comme un lieu pour former des citoyens, et pas seulement des travailleurs. « On a tendance à croire qu’augmenter le niveau de diplôme règle tous les problèmes de chômage. Mais personne ne se demande si c’est réellement le cas. Qui osera proposer une autre voie pour ouvrir les portes de l’emploi ? »
TEXTE : Forêts ANNIKA et SAGASAND